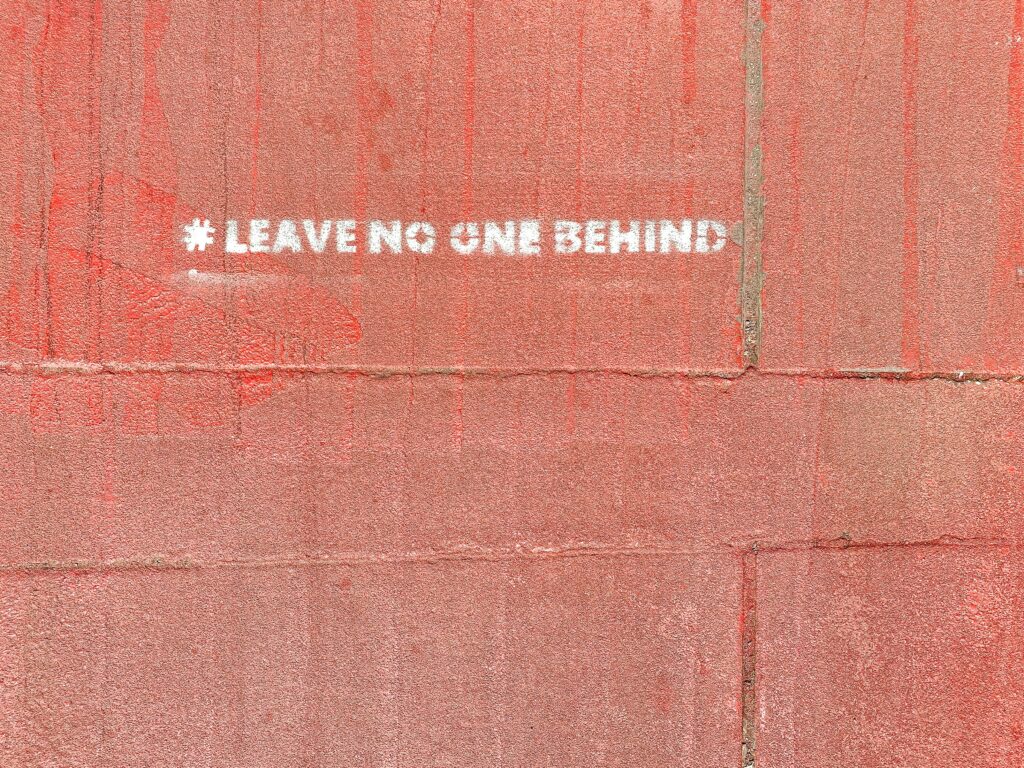
Les raisons qui forcent les hommes et les femmes à quitter leur pays d’origine sont diverses : études, travail, protection internationale. Il existe cependant des motifs de migration spécifiques aux femmes. En Belgique, c’est le regroupement familial qui est, depuis plusieurs années, la principale voie d’entrée des femmes sur le territoire, et ce malgré le caractère restrictif de cette procédure.
Des droits conditionnés
Les femmes qui arrivent en Belgique par regroupement familial sont pour la plupart venues rejoindre un conjoint ou un partenaire [1]. À l’issue d’une procédure de visa ou de séjour contraignante, au cours de laquelle le conjoint devra notamment justifier d’une solide situation financière, les femmes se voient remettre une carte de séjour d’une durée variable (1 ou 5 ans) selon la nationalité de leur conjoint. Elles se voient aussi reconnaître des droits : travailler, se former, entreprendre des démarches d’équivalence de diplôme ou encore de suivre un parcours d’intégration. Et pour maintenir ces droits, elles doivent remplir des conditions : prouver leurs efforts d’intégration (langue, recherche d’emploi, etc.), ne pas dépendre des pouvoirs publics et maintenir pendant 5 ans au moins une vie familiale commune et effective avec leur conjoint. Cette dernière condition place d’emblée les femmes dans une situation de dépendance administrative et de vulnérabilité potentielle. Car, en cas de violences, la carte de séjour devient une arme, un moyen pour l’auteur des violences de maintenir une emprise. La menace du retrait de la carte de séjour, des droits (notamment vis-à-vis des enfants) et de l’expulsion vers le pays d’origine, devenant le meilleur moyen de contrôler le comportement des femmes.
Des obstacles spécifiques face aux violences du partenaire
Si les femmes arrivées par regroupement familial ne sont pas plus souvent victimes de violences que les autres, elles rencontrent des obstacles spécifiques en termes d’accès à la protection prévue par la loi belge. Ces difficultés résultent d’une part de leur situation individuelle : isolement social, méconnaissance de la langue et/ou du fonctionnement du pays, dépendance financière à l’égard du partenaire, sentiment de honte face à l’échec du projet conjugal, familial ou migratoire, etc. Elles résultent aussi du cadre réglementaire ou institutionnel qui s’impose à elles : dépendance administrative engendrée par la loi sur le regroupement familial, accès conditionné aux revenus dans les maisons d’accueil pour victimes de violences, statut migratoire qui prime sur le statut de victime dans la plupart des services de police, etc.
Un cadre légal de protection insuffisant
La loi sur le regroupement familial prévoit quelques rares exceptions à l’obligation de vie commune pendant 5 ans. Celles-ci permettent notamment aux victimes de violences qui quittent le domicile de demander le maintien de leur séjour en Belgique auprès de l’Office des étrangers. Mais encore faut-il, pour être effectif, que les victimes soient informées de l’existence de ce cadre de protection et qu’elles soient en mesure de l’activer. Il empêche par ailleurs une protection de toutes les victimes de violences, car la loi ne permet qu’aux femmes qui ont déjà une carte de séjour d’en demander le maintien en cas de départ du foyer violent. Pas à celles en attente d’une décision à leur demande de regroupement familial ni à celles sous visa en vue de mariage et encore moins aux femmes sans-papiers. S’ajoutent à cela d’autres difficultés : la nécessité de signaler rapidement à l’Office des étrangers les violences et d’en apporter des preuves écrites, la possibilité pour l’Office des étrangers de retirer la carte de séjour dès la fin de l’installation commune ou encore le pouvoir d’appréciation trop large de telles situations, laissé à une administration non spécialisée en la matière.
Pour une loi sur le séjour qui lutte contre les discriminations et les violences faites aux femmes
Si des efforts ont été faits ces dernières années pour tenir compte de la situation spécifique des femmes migrantes face aux violences [2], aucune modification significative de la loi sur le séjour des personnes étrangères n’a été entreprise à ce jour. Seules quelques clarifications ont été apportées par la circulaire du 29 novembre 2023 visant « à mieux informer les victimes de violences intrafamiliales ainsi que les divers acteurs concernés sur les clauses de protection existantes en matière de séjour, sur les conditions et sur les procédures à suivre ». De plus, la Belgique est encore loin, en ce qui concerne les femmes migrantes, des engagements pris lors de la ratification de la Convention d’Istanbul en 2016 et des recommandations du GREVIO. En 2020, celui-ci pointait l’incapacité de la Belgique à intégrer de manière transversale la question des discriminations multiples. Il l’invitait à entreprendre « une révision en profondeur des lois et politiques en matière d’immigration afin de les aligner sur les obligations prévues à l’article 59 de la Convention d’Istanbul » [3].
[1] Ce sont généralement les hommes qui quittent le pays en premier et les femmes qui les rejoignent, raison pour laquelle nous n’utilisons pas ici l’écriture inclusive.
[2] Notamment dans le cadre des mesures prévues par le Plan d’action national de lutte contre les violences basées sur le genre 2019-2024.
[3] La Convention d’Istanbul impose aux États de permettre aux victimes de violences dont le statut de séjour dépend de leur conjoint de demander un titre de séjour autonome et d’être protégées d’une expulsion en cas de séparation et ce quelle que soit la durée de la relation.
Pour aller plus loin
Analyses du Ciré ASBL :
• Lutte contre les violences faites aux femmes migrantes : où en est la Belgique ?
• Mesures « asile et migration » du Plan d’action national de lutte contre les violences basées sur le genre
• Les femmes sans papiers : à l’intersection de plusieurs formes de violences et systèmes de domination
Autres :
• Regroupement familial et violences domestiques, outiller les professionnel.les : état des lieux et perspectives : edito_juin_2024.pdf
• État des lieux de la coalition « Genre et Migration » : Accueil – Coalition genre & migration
• Rapport alternatif de la coalition « Ensemble contre les violences » de février 2019








